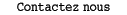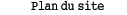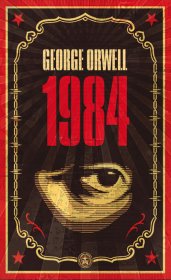1984 est un roman tristement célèbre et largement inconnu. Sa célébrité se résume à quelques images d’absolue méchanceté et à ce sentiment de cauchemar qu’évoque l’adjectif « orwellien ». Si l’on y fait référence, ce n’est que pour susciter effroi et indignation, lorsque l’on dénonce les nouveaux « Big Brother », la « novlangue », les télécrans... Ce livre a-t-il été écrit pour entretenir la peur plutôt que pour nous la faire comprendre ? En l’agitant comme un épouvantail, on lui a fait dire le contraire de ce qu’il raconte.
Orwell avait prévu le détournement idéologique de son oeuvre. A propos de La Ferme des Animaux, satire de la révolution soviétique écrite en 1943 et refusée par les éditeurs anglais tant que la Russie était alliée au Royaume-Uni, il avait écrit : « D’après tout ce que je sais, il se peut que, lorsque ce livre sera publié, mon jugement sur le régime soviétique soit devenu l’opinion généralement admise. Mais à quoi cela servira-t-il ? Le remplacement d’une orthodoxie par une autre n’est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c’est l’esprit réduit à l’état de gramophone, et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. » (« Préface inédite à Animal Farm »(1945) in Essais, articles, lettres, vol.III, Paris, Ed.Ivréa/Encyclopédie des Nuisances, 1998, pp.517-518.)
C’est ce qui s’est passé également avec 1984 : il connut un immense succès non pas en tant que critique du totalitarisme planétaire, mais en tant que dénonciation des régimes soviétique, nazi et fasciste. Il était censé donner aux gentils citoyens du monde libre une idée de l’horreur de ce qui se passait au loin, chez les ennemis présents ou passés. Or, c’est bien là l’un des traits du totalitarisme selon Orwell : diaboliser l’ennemi, projeter sur lui tout le mal pour nous en innocenter et justifier notre Etat, nos bombes, nos tortures, notre système coercitif. Dès le début, 1984 a ainsi été transformé en référence de l’idéologie totalitaire !
Aujourd’hui, du fait de la grotesque hystérie policière et de la grossièreté grandissante des moyens employés par les Etats capitalistes pour écouler leurs stocks de bombes et de gadgets punitifs, il devient de plus en plus difficile de nier que 1984 décrit aussi ce qui se passe chez nous. Les bien-pensants continuent cependant à l’utiliser au service de leur morale totalitaire : ils dénoncent l’ignominie des flics et des tyrans pour mieux innocenter et victimiser le citoyen. " Regardez comme les méchants sont méchants ! Comme ils sont puissamment armés ! "
En dénonçant toujours et encore la toute-puissance du système totalitaire, de sa police, de ses caméras de vidéosurveillance, de son contrôle idéologique, les pieux défenseurs des libertés civiles ne font que renforcer son pouvoir et l’efficacité de ses instruments : capter notre attention, nous faire peur, nous faire croire que nous sommes dépossédés du pouvoir sur notre vie, nous menacer d’un Enfer de condamnations et de tortures si nous n’obéissons pas. En réalité les caméras ne servent à rien si les citoyens ne se sentent pas surveillés : elles sont là pour qu’ils intériorisent la domination, pour qu’ils se contrôlent eux-mêmes, ainsi que le décrit 1984. L’emprise d’un empire sur nos vies est avant tout un idéal et cet idéal - cette utopie - n’est réel que pour autant que nous nous y soumettons, pour autant que nous y croyons. « Big Brother » n’existe pas, ce sont les citoyens eux-mêmes qui portent et réalisent son règne, qui se condamnent, se surveillent, se dénoncent les uns les autres et en eux-mêmes : voilà ce que raconte 1984, à l’opposé de ce qu’on lui a fait dire, de ce qu’on lui fait dire aujourd’hui encore, à notre époque où la critique sociale est devenue le ton dominant, où tout un chacun dénonce le mal commis par les puissants sans y reconnaître sa propre puissance. C’est pourquoi nous avons encore à lire 1984, à le relire pour le débarrasser des dogmes partisans et des catégorisations scolaires qui empêchent que nous lui prêtions notre pleine attention.
Un roman
Avant tout, 1984 est un roman. Sa forme romanesque n’est pas l’emballage littéraire d’un message politique, mais est au contraire ce qui lui garantit son efficacité critique. Il raconte une expérience vécue, celle de Winston Smith, un membre du Parti au pouvoir, un individu au beau milieu du système totalitaire, qui le hait et pourtant y participe. Le crime héroïque que Winston commet vis-à-vis du Parti consiste à tenir un journal intime : ainsi Orwell met précisément en avant, contre le totalitarisme, l’écriture de la vie subjective individuelle. Le pouvoir du roman contre le totalitarisme, c’est déjà de constituer une histoire humaine particulière qui ne se réduit pas à l’Histoire officielle, une libre mémoire et un appel à la mémoire de chacun, car l’Etat totalitaire brûle les livres et amoindrit la mémoire de ses sujets pour pouvoir réécrire sans cesse l’Histoire à son avantage. Mais c’est surtout son immersion dans l’expérience subjective des hommes qui fait la force du roman. Il ne critique pas le totalitarisme comme les ministres et les sociologues : vu d’en haut, de loin, comme une théorie, comme un système abstrait. Il n’en fait pas une dénonciation moralisante. Il le décrit comme une chose que vivent les hommes : comment ils le pensent, comment ils le ressentent, comment ils le font eux-mêmes.
Cette perspective subjective lui permet de décrire dans le détail le fonctionnement concret de l’Etat totalitaire : comment les gens connaissent et perçoivent la terreur policière, quelles sont leurs stratégies individuelles pour y survivre et comment ces stratégies les emprisonnent d’autant mieux, comment le Parti manipule les forces inconscientes, le désir sexuel, la frustration, la haine, quel est ainsi le régime émotionnel qui perpétue la terreur et l’embrigadement... 1984 est une contre-utopie : il ne décrit pas comment une Cité idéale pourrait fonctionner, mais comment nous faisons présentement fonctionner l’absurde domination de cet idéal sur nous-mêmes, comment il se réalise en hostilité de tous contre tous.
Le roman est la forme littéraire qui éclaire la vanité des aventures humaines, vanité qui tient à la séparation essentielle entre le sujet et le monde, et à l’enthousiasme qui habite pourtant le sujet de dépasser seul cette séparation en agissant dans le monde. Or, 1984 montre que ce vain orgueil est le coeur, le principe vivant du totalitarisme. Orwell raconte la confrontation entre deux sujets héroïques, Winston Smith et O’Brien, le policier qui le surveille, le guide et tente de le soumettre ; il montre que le Parti, à travers O’Brien, doit s’efforcer à réaliser sa domination avec la même incertitude essentielle que Winston éprouve à vivre libre, avec le même besoin de reconnaissance. L’aventure par laquelle Winston veut se rebeller et qui se finit dans la salle de torture est l’aventure indispensable au Parti, sa seule et unique façon d’être ce qu’il prétend être : il n’éprouve sa propre puissance qu’en soumettant la conscience de Winston, en l’obligeant à reconnaître et accepter son règne. Car ce règne n’existe nulle part ailleurs qu’entre les hommes.
1984 ruine l’idée que le système totalitaire soit un pouvoir absolu qui existe sans nous et par-dessus nos têtes. Le Parti est, comme le héros romantique, un sujet politique habité par un idéal, celui d’exprimer totalement la société, de réaliser la communauté vraie, libre et éternelle, mais il n’est jamais reconnu comme tel que passagèrement, au prix de l’assujettissement de chacun de ses membres. Sa misère est d’être dépendant de la vie des rebelles qu’il réprime et des coupables qu’il corrige, c’est pourquoi il doit faire régner sans cesse, éternellement, la contradiction et la souffrance : car naissent sans cesse de nouveaux hommes à convaincre. La réalisation de son idéal est un supplice infernal que les membres se font subir les uns aux autres.
L’espoir avant le désespoir
Orwell ne s’arrête pas à cette révélation de la logique infernale du totalitarisme. Sa critique romanesque va plus loin : Winston et O’Brien sont confusément conscients de l’absurdité de leur conflit et nourrissent tous deux l’espoir d’arriver à se comprendre vraiment. L’horizon de 1984 est cette possibilité de dépasser l’antagonisme entre la liberté individuelle et la volonté de l’Etat, où l’une se définit contre l’autre et fait de l’autre son bouc-émissaire.
Car cette alternative est elle-même un piège totalitaire, comme le montre 1984 : c’est la Police de la Pensée qui incite Winston à espérer la liberté et l’encourage à chercher une autonomie à l’intérieur de sa solitude forcée. Le totalitarisme cultive l’individualité car il est construit sur l’isolement et la séparation entre les hommes, sur l’absence de communauté, sur le désir de communauté. Il se présente comme solution à cette séparation, comme communauté idéale. Il est donc vain de chercher dans l’individu abstrait une solution inverse : il ne s’y trouve que le martyre, la mystique égoïste ou la médiocrité des super-héros. La plupart des commentateurs de 1984 cherchent pourtant à faire de ce roman une oeuvre de défense de la liberté individuelle selon l’idéal capitaliste. Le véritable adversaire du totalitarisme, ça n’est pas l’individu, c’est la vie sociale. C’est pourquoi Winston voit dans la masse inculte des « Prolos », que le Parti dédaigne, une force de vie bien plus prometteuse que la fausse contestation des rebelles politisés.
Cependant, 1984 ne fait que suggérer l’espoir d’une sortie hors du piège totalitaire sans la trouver effectivement. Le roman se finit sur le triomphe de la torture, la reconnaissance de la toute-puissance de la souffrance produite et rendue objective par les outils de la Police de la Pensée. Ce sont des machines qui réussissent à vaincre la volonté de Winston et à lui arracher son adhésion au Parti. La loi de la douleur, de l’angoisse et de la peur se présente comme le décevant deus ex machina du problème totalitaire. De même, l’économie politique peut rationaliser la vie humaine en faisant du plaisir et de la jouissance des lois objectives de l’esprit. A la science de la torture fait écho celle du marketing, celle du Meilleur des Mondes, de même qu’à la liberté de l’individu bourgeois répond toujours indissociablement la contrainte policière.
Avec la torture, ce n’est pas seulement Winston qui est vaincu, mais aussi le doute critique que le roman développait, et son espoir d’un dépassement du vain conflit. Car il concède que, même si la domination du Parti est absurde, il a les moyens techniques de faire régner son absurdité éternellement. Il finit, comme un roman policier, grâce à une certitude d’ordre technique. C’est pourquoi 1984 est en quelque sorte un roman raté, qui laisse trop facilement oublier le fruit de sa conscience romanesque. En faisant triompher la peur et le cauchemar, Orwell a permis qu’on réduise son oeuvre à une sorte de film d’horreur, à un exemple de martyre où se complaît l’esprit bourgeois. Et qu’on fasse silence sur la profondeur de sa critique.
Cette profondeur ignorée est aussi conceptuelle. Car le problème du totalitarisme a emmené Orwell très loin, jusqu’à l’analyse des fondements de la sociabilité et de l’histoire des hommes. Sur le chemin des pensées de Winston Smith, puis dans son combat spirituel contre O’Brien, contre la folie du Parti et de sa « doublepensée », et jusque dans la torture, Orwell étudie la signification sociale de la mort, du désir sexuel, de l’angoisse, de la parole, de l’objectivité, de la vérité. Ce sont de véritables Méditations Métaphysiques sous la forme d’une confrontation policière entre l’individu et l’Etat, dans laquelle le sujet politique cherche à trouver la certitude d’un « cogito ergo sum » en se dépouillant peu à peu de ses déterminations inessentielles, sans jamais en trouver une qui lui permette de posséder vraiment la vie sociale. Ou de lui échapper.
Lire : Pierre Bourlier, Au coeur de 1984, Strasbourg, Verbigédition et lulu.com, 2008.
(disponible ici)
lire la préface en ligne