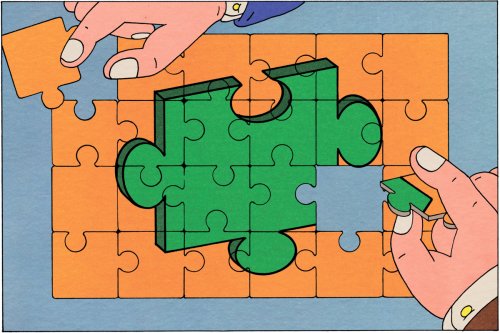Accueil > Agenda > CQFD, journal de critique sociale
Articles
-
Un empire nommé Ubi
13 septembre, par Ugo Trelis — Garte, Le dossier
Chez Ubisoft, l'un des plus grands studios de développement de jeux vidéo au monde, le harcèlement semble être solidement ancré au sein de la culture d'entreprise.
Tous les gamers adorent détester Ubisoft. Depuis sa création en 1986 par les cinq frères Guillemot, l'entreprise est régulièrement la cible de moqueries quant à la qualité finale ou le manque d'originalité de ses jeux. En 2020, le studio français donne une bonne raison de le détester. Dans une enquête accablante, Libération révèle l'ambiance de vestiaire qui règne entre les murs de l'entreprise : tentatives d'agressions sexuelles lors d'évènements professionnels, commentaires islamophobes, harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les salles de pause ou de réunion... Trois anciens salariés d'Ubisoft sont condamnés, au début de l'été 2025, à des peines de prison avec sursis et des amendes. L'entreprise n'a pas été poursuivie, alors que les syndicats l'avaient accusé de « harcèlement institutionnel ». Et si Ubisoft était le prototype de l'entre-soi masculin, du sexisme et des rythmes de travail intenses qui caractérisent aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo ?
À l'origine : le crunchLe fief devenu empire semble avoir développé un goût pour l'entre-soi masculin, les inégalités de genre et les conditions de travail déplorablesEn anglais, crunch se traduit par « moment critique » ou « écraser ». Dans l'industrie du jeu vidéo, le crunch désigne cette période intensive où les développeur·ses doivent travailler 50 à 70 heures par semaine, parfois plus, pour atteindre des objectifs de production. En 1988, les frères Guillemot ne sont pas les seuls à faire cruncher leurs employés, mais ils le font avec panache. Ils se font notamment remarquer en réunissant, pendant plusieurs jours, des développeurs dans un château situé dans la région de Rennes. À l'époque, le magazine jeu vidéo Tilt, invité par le studio, fait le récit de ce huis clos dans un article au titre glamour : « Les princes programmeurs de Brocéliande ». Les équipes, essentiellement masculines, travaillent jour et nuit et partagent des chambres ensemble. Selon le journaliste, la vie de château vise à : « créer une ambiance permettant aux programmeurs, graphistes et autres musiciens de donner pleine mesure à leurs capacités respectives mais aussi communes ». Difficile de ne pas voir dans ce « team building » quasi féodal la préfiguration d'un habitus appelé à s'enraciner durablement dans l'industrie du jeu vidéo : le crunch comme épreuve virile à traverser ensemble.
De la vie de château à la vie d'entrepriseCette stratégie est contestée à mesure qu'Ubisoft grandit et la discorde donne lieu à Ubifree, la première tentative de syndicalisation au sein du studio. L'aventure est de courte durée, de 1998 à 1999, mais elle reflète une certaine clairvoyance. Composée d'une quarantaine de personnes, la cellule exprime des demandes claires : des contrats pérennes et de meilleures conditions de travail. Dans les discussions qui peuvent être consultées sur le site internet d'Ubifree, on trouve des commentaires qui témoignent de l'évolution de la culture masculine à Ubisoft depuis la vie de château. « La virilité se porte bien à Ubi », écrit un membre anonyme. Iel fait le constat de l'androcentrisme de l'entreprise familiale qui entretiendrait l'asymétrie parmi ses salarié·es : décontraction entre hommes ; distance formelle avec les femmes. Les différences hiérarchiques entre les hommes sont effacées par « le tutoiement des frères [Guillemot], signe ultime de la proximité bienheureuse avec eux ». Le fief devenu empire semble avoir développé un goût pour l'entre-soi masculin, les inégalités de genre et les conditions de travail déplorables.
Ce n'est pas un bug, c'est une featureAu lendemain des révélations médiatiques de 2020, que reste-t-il de cette culture d'entreprise ? Pierre*, embauché à Ubisoft en 2021 fait part de l'ambiance mitigée qui règne dans les bureaux situés à Saint-Mandé, à côté de Paris. On use d'euphémismes pour ne pas prononcer les termes de « violences sexistes et sexuelles ». Les employé·es évoquent pudiquement « ce qu'il s'est passé ». Parfois, son manager, cadre à Ubisoft depuis presque 30 ans, évoque la « chasse aux sorcières » déclenchée par Libération, et regrette l'ancien monde. Il redoute les « teams building » et les fêtes d'entreprises par crainte d'agir d'une façon jugée inappropriée par les nouvelles politiques des ressources humaines. Ces dernières ne font pas l'unanimité non plus auprès d'autres employés. Pierre se remémore une réunion générale en ligne au cours de laquelle Anika Grant (la « Chief People Officer » ou responsable des ressources humaines d'Ubisoft de 2021 à 2023) a présenté une plateforme dédiée au traitement de plaintes anonymes en entreprise. Des salariés, indignés, s'envoient des messages : qu'en est-il de la liberté d'expression, des fausses accusations et de la présomption d'innocence bafouée ? Les pouces en l'air et les cœurs, marqueurs modernes de la vie d'entreprise dématérialisée, apparaissent en nombre sous ces publications. La culture Ubi persiste, et le « changement structurel » souhaité par Yves Guillemot en 2020 semble relever d'un mirage. Le changement, le vrai, se trouve peut-être dans la tentative éphémère d'Ubifree. L'intensification récente des luttes syndicales dans l'industrie du jeu vidéo a notamment été catalysée dans un mouvement de grève important à Ubisoft en novembre 2024. Il porte en lui la promesse de mobilisations futures et d'un changement qui ne viendra pas des managers et de leur hiérarchie, mais des travailleurs et des travailleuses.
Ugo Trelis* Prénom modifié à sa demande
-
Les militants indépendantistes kanak face à la justice française
13 septembre, par Niel Kadereit, Pierre Onraed — Djaber, Actualités
Pour s'être levés contre le projet de loi de dégel du corps électoral calédonien au cours de l'année 2024, des centaines de militants indépendantistes kanak se sont retrouvés devant les tribunaux, avec parfois des peines de prison ferme à la clef. L'association Urgence Kanaky recense depuis plusieurs mois ces condamnations.
Le 31 mai 2024 au soir, K. et N., deux militants indépendantistes kanak, sont arrêtés sur un barrage routier – une carcasse de voiture au milieu de la voie – dans la commune de Mont-Dore, banlieue urbaine de Nouméa, tout au sud de la Grande Terre. Ils participent au mouvement de protestation contre le projet de loi constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral calédonien. Pour les Kanak, peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, c'est une manière d'étouffer leur poids politique et de rendre inaudible leurs revendications d'autodétermination. En réaction, la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) appelle à la mobilisation.
L'enjeu pour la France est d'enrayer rapidement la mobilisation en s'en prenant autant aux militants de base qu'aux leaders politiquesLa répression policière ne se fait pas attendre. Rapidement, les effectifs de gendarmerie explosent, l'armée est déployée et les centaures1 quadrillent la banlieue de Nouméa. La jeunesse marginalisée des quartiers s'en prend alors aux grandes enseignes implantées dans la capitale, symbole de la richesse inégalement répartie sur le territoire. Les incendies et les pillages se multiplient chaque nuit pendant ce mois de mai malgré le couvre-feu imposé. À l'abri des regards, l'appareil judiciaire s'enclenche : l'enjeu pour la France est d'enrayer rapidement la mobilisation en s'en prenant autant aux militants de base qu'aux leaders politiques et d'anéantir toute velléité de soulèvement.
234 personnes incarcéréesDès juin 2024, sept responsables de la CCAT sont transférés dans des prisons métropolitaines2. À partir du 13 mai, jour où le projet de loi constitutionnelle arrive à l'Assemblée nationale, 2 530 Kanak sont placés en garde à vue, selon les chiffres du procureur de la République Yves Dupas. Photos, relevés d'identité, prises d'empreintes, l'occasion d'un fichage massif des activistes. Pour comprendre l'ampleur de cette répression, il faut avoir en tête les ordres de grandeur : en quelques mois, c'est un peu plus de 2 % des autochtones de l'île qui sont arrêtés. Si l'on ramène ce chiffre à l'ensemble de la population française, cela concernerait plus d'un million d'habitants. 600 d'entre eux sont finalement relâchés sans poursuites. Pour les autres : interdictions de manifester, sursis, assignations à résidence, convocations en justice, mandats de dépôt, déferrements. Autant de jugements qui restreignent le pouvoir d'action politique des indépendantistes. Au total sur la période 243 personnes sont incarcérées.
En quelques mois, c'est un peu plus de 2 % des autochtones de l'île qui sont arrêtésK. et N. font partie de ceux-là. Lors de son arrestation, N. brandit une chaise face à un policier qui pointe vers lui son pistolet LBD. K. est quant à lui arrêté en possession d'une fronde et de boulons. Ils sont emmenés devant le tribunal correctionnel de Nouméa le 3 juin après avoir passé 48 heures en garde à vue. Comme beaucoup d'autres Kanak à cette période, ils passent en comparution immédiate, une procédure qui permet à la justice de juger des affaires sans enquête, en se fondant uniquement sur la confrontation entre les dépositions des plaignants, ici deux gendarmes, et l'interrogatoire des prévenus. Selon l'un des policiers, K. serait l'auteur des jets de boulons qu'a essuyés sa petite compagnie de gendarmes un peu plus tôt dans la soirée sur le même barrage. Les deux militants se retrouvent alors accusés « d'entrave à la circulation d'un véhicule sur la voie publique », de violences contre les forces de l'ordre n'entraînant pas d'incapacité et de « rébellion ». Ils sont condamnés à neuf mois de prison ferme au Camp Est. L'un des pires lieux d'enfermement français, régulièrement pointé du doigt par l'Observatoire international des prisons pour ses conditions de vie indignes et dégradantes. Même pour des courtes peines ou des détentions provisoires, l'incarcération au Camp Est est vécue comme une expérience traumatisante.
« Dans les premières semaines, il fallait frapper fort pour mater la révolte », observe Dominique Onraed, membre d'Urgence Kanaky. Une association de soutien aux prisonniers qui recense les motifs de condamnation des personnes inculpées dans le cadre de leur participation aux révoltes entre le 21 février 2024 et le 1er octobre 2024. Autrement dit, entre le jour des premières arrestations de manifestants et la date à laquelle Michel Barnier, alors Premier ministre, s'engage à ne pas faire passer le projet de loi devant le Congrès. Urgence Kanaky a déjà pu recenser une soixantaine d'affaires en se rendant aux audiences du tribunal correctionnel de Nouméa et en récupérant les décisions. Parmi les condamnés, surtout des hommes, dont la moyenne d'âge se situe autour de 35 ans, résidant essentiellement dans le Grand Nouméa, où se cristallise la ségrégation entre Kanak et Métropolitains.
Du ferme pour une infraction au Code de la route« Ce sont des prisonniers politiques mais comme ils ne font pas partie des leaders ils ont été invisibilisés »Un chef d'accusation revient souvent dans les comptes rendus de jugement : « entrave, en Nouvelle-Calédonie, à la circulation d'un véhicule sur une voie publique ». Une infraction au code de la route employée comme un instrument de criminalisation d'un mode d'action politique historique des indépendantistes Kanak : le barrage filtrant. Pour le blocage d'un embranchement d'une route territoriale le 29 mai 2024, deux militants sont condamnés à quatre mois de prison sans mandat de dépôt. Henri Juni, syndicaliste de 54 ans, a lui pris douze mois pour avoir bloqué durant quelques heures l'accès à l'usine de la Société Le Nickel, une entreprise minière exploitant les sols de la Nouvelle-Calédonie. Durant la nuit du 8 au 9 mai, des palettes et des pneus enflammés sont disposés au milieu de la route. Pour les pneus, la charge de « dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion » est également retenue contre lui. Lorsque les forces de police arrivent, Henri Juni et ses camarades évacuent les lieux sans affrontements après un petit moment de négociation. Marcel Toyon, militant associatif également présent ce jour-là, écope de huit mois de prison pour complicité d'entrave à la circulation d'un véhicule sur une voie publique.
« Vous trouvez que les émeutes c'est de la politique ? »Rébellion, outrage, participation à un groupement formé en vue de commettre des violences contre les biens ou les personnes ou encore violences sur agent des forces de l'ordre sont les autres charges qui reviennent régulièrement dans les motifs d'inculpation pour les Kanak participant aux révoltes. « Les peines qui ont été prononcées sont très lourdes au regard de la nature des infractions, estime Marion Declercq, de l'association Urgence Kanaky. Ce sont des prisonniers politiques mais comme ils ne font pas partie des leaders ils ont été invisibilisés. » L'État, et ses magistrats, dans un geste de délégitimation, poursuivent ces personnes pour des infractions de droit commun et dénient tout caractère politique à leurs actions. Ainsi un juge lance, le 13 août 2024, lors d'une audience au tribunal correctionnel de Nouméa à une personne accusée de jets de pierres sur la police : « Vous trouvez que les émeutes c'est de la politique ? Le caillassage, les émeutes, les incendies, ça n'est plus de la politique. » On aimerait lui retourner la question : vous trouvez qu'un soulèvement populaire contre une loi menaçant un processus de décolonisation ce n'est pas de la politique ?
Pierre Onraed et Niel Kadereit
-
Collectif Afrogrameuses : « Certains hommes blancs considèrent encore le jeu vidéo comme leur chasse gardée »
6 septembre, par Gaëlle Desnos — Garte, Le dossier
Sur la scène vidéoludique, un univers où le jeune mâle blanc et hétérosexuel semble régner en maître, difficile, quand on vient des marges, de déverrouiller la partie. Entretien avec Jennifer Lufau, consultante et fondatrice de l'association Afrogameuses.
Dans le monde, 48 % des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses, et même des utilisatrices régulières, c'est-à-dire plus d'une fois par semaine, voire quotidiennes pour 56 % des 16-30 ans. Quant au public non blanc, il semble qu'il soit tout aussi présent dans la communauté. Alors pourquoi ce tenace sentiment que le jeu vidéo, son industrie et son écosystème, demeure la chasse gardée de quelques hommes blancs ? Parce que tous les autres ont été et sont encore invisibilisés, tranche Jennifer Lufau. Cette consultante accompagne la création d'univers immersifs et authentiques, et milite au sein de l'association Afrogameuses pour la visibilité des joueurs et joueuses non blancs sur la scène vidéoludique. Elle nous a expliqué comment le jeu vidéo a été colonisé par des stéréotypes raciaux et sexistes, mais aussi comment, depuis les marges, la résistance s'organise...
Quelle part représente les minorités au sein de l'industrie des jeux vidéo ? Comment y sont-elles accueillies ?
« L'idée selon laquelle le jeu vidéo est avant tout masculin et blanc s'est solidement ancrée »« Au niveau de la parité, les femmes ne représentent que 24 % des professionnels du secteur et les personnes non binaires 5 %. Sur le plan ethnique, la France ne fait pas ce genre de statistiques, donc on ne peut s'en tenir qu'aux perceptions. Mais depuis mon expérience, je peux dire que l'industrie française du jeu vidéo reste peu diverse. J'y suis entrée via Ubisoft, en pleine vague d'accusations de discrimination et de harcèlement sexuel [lire « Un empire nommé Ubi » page 8]. C'était un peu anxiogène mais j'avais besoin de travailler et ce studio est une case à cocher dans le milieu. Heureusement, je n'ai pas été victime de harcèlement. Mais j'ai vite compris que j'étais une des seules personnes non blanches de la boîte et qu'il faudrait que je fasse mes preuves plus que quiconque. Au début, on me prenait pour une stagiaire, je devais tout le temps préciser que j'étais en CDI. Je faisais partie d'un groupe travaillant à améliorer la représentation des personnes noires en interne et avec mon engagement militant en dehors, on me sollicitait beaucoup sur ces questions. Mais j'ai peu à peu eu le sentiment d'être utilisée comme un token1. Si je ne mettais pas des limites, ces demandes empiétaient sur mon temps de travail. En fin de compte j'ai constaté que j'étais moins payée que des collègues arrivés après moi, avec moins d'expérience, dans la même équipe. C'était clairement le signal que je n'évoluerais pas chez Ubisoft et je suis partie. »
Quels sont les freins principaux à l'inclusivité dans cette industrie ? Pourquoi semblent-ils autant persister ?
« Pour comprendre, il faut remonter au début des années 1980. À l'époque plusieurs études documentent une forte représentation des hommes parmi les joueurs de jeux vidéo. Nintendo décide alors d'ajuster sa stratégie et lance une nouvelle console, la NES, marketée pour les jeunes garçons blancs des banlieues pavillonnaires américaines. Le succès est immédiat. Dans la foulée, la marque sort l'un de ses produits les plus emblématiques : la Game Boy. Un nom qui ne laisse plus aucun doute sur son cœur de cible ! Ensuite, l'industrie va peu à peu se mettre à concevoir des jeux à l'aune de ce qu'elle suppose être les attentes du consommateur type : combat, sport, armes, voitures…
« Il m'a fallu dix ans de gaming avant de jouer un personnage de femme noire pour la première fois »Aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment autant de joueurs que de joueuses dans le monde. Et les personnes non blanches sont aussi très nombreuses ! Mais l'idée selon laquelle le jeu vidéo est avant tout masculin et blanc s'est solidement ancrée. Ça s'accompagne d'un fort gatekeeping [littéralement « garder la porte », autrement dit le fait de contrôler l'accès à un espace, une communauté, une activité ou un savoir, de manière arbitraire ou discriminatoire, ndlr] de la part d'hommes qui considèrent encore le jeu vidéo comme leur chasse gardée. Certaines pratiques sont même dépréciées : quand tu ne joues pas à des FPS [« First-Person Shooter », un genre de jeu vidéo où l'on voit l'action à travers les yeux du personnage, souvent avec une arme visible au bas de l'écran, ndlr], à des jeux de guerre ou très difficiles, on ne considère pas que tu es un gamer [un joueur, ndlr]. L'industrie de la création vidéoludique a donc quasiment été configurée par et pour des hommes blancs. Difficile, quand on est une femme, non blanc ou quand on a des pratiques de jeu différentes, de se faire une place. »
Cela va aussi avoir un impact au sein des jeux avec un déficit de personnages principaux femmes ou non blancs…
« Aujourd'hui, les personnages de femmes ou non blancs sont plus présents qu'avant, mais on se contente trop souvent de puiser dans des clichés pour les concevoir »« Dans les jeux, il y a longtemps eu toutes sortes de créatures imaginaires : des monstres, des robots, des elfes… Mais des avatars féminins noirs, c'était quasi inimaginable ! Pour ma part, il m'a fallu dix ans de gaming avant de jouer un personnage de femme noire pour la première fois. Je me souviens de l'impact immense que ça eu sur moi : je me suis rendue compte que j'avais le droit d'exister dans ce monde-là. Diamond Lobby, un site spécialisé dans le gaming, a enquêté sur 100 jeux majeurs sortis entre 2017 et 2021. Les résultats sont accablants : 80 % des protagonistes principaux sont des hommes, plus de la moitié sont blancs, le reste représentent toutes les autres origines, et 8 % seulement sont à la fois femmes et non blanches. On est vraiment loin du “grand remplacement wokiste” invoqué par les geeks mascu ! »
Comment les studios, majoritairement composés d'hommes blancs, peuvent-il créer des personnages racisés, féminins crédibles ?
« Effectivement, à partir du moment où les studios sont majoritairement masculins et blancs, la question se pose. Aujourd'hui, les personnages de femmes ou non blancs sont plus présents qu'avant, mais on se contente trop souvent de puiser dans des clichés pour les concevoir. Je pense notamment au tout dernier Tekken : Miary Zo, une combattante malgache, y est représentée en haut de bikini et mini-short moulant, avec des accessoires de style “tribal”. Cacao et Vanilla, deux petits lémuriens, l'animal emblématique de Madagascar, l'accompagnent. Une exotisation typique. Même l'excellent jeu Banishers : Ghosts of New Eden n'échappe pas à certains écueils : son unique personnage noir meurt dès le départ. Pourtant ce trope narratif raciste dans lequel le personnage noir meurt en premier dans les œuvres de fiction, le “Black Guy Dies First”, a été identifié depuis les années 1970-80 !
« La question ne résume pas à une affaire de quotas de personnages noirs ou féminins : il y a un véritable enjeu autour de la représentation du monde non occidental »Est-ce que les studios doivent pour autant renoncer à créer ces personnages ? Je ne crois pas. Je suis convaincue qu'on peut tous raconter des histoires qui ne nous appartiennent pas. Il suffit d'avoir envie de le faire avec justesse, de s'entourer des bonnes personnes, de faire des recherches, de travailler les personnages, leur langue, leur culture… Et de ne pas le faire seulement pour éviter le bad buzz. »
Et au-delà des personnages, les univers, les codes visuels et les arcs narratifs sont aussi occidentalo-centrés…
« Tout à fait, la question ne résume pas à une affaire de quotas de personnages noirs ou féminins. Il y a un véritable enjeu autour de la représentation du monde non occidental. Celui-ci est peu représenté, et quand il l'est, c'est bien souvent à travers le prisme colonial. Parmi les exemples les plus marquants : Resident Evil 5. L'action se déroule en Afrique subsaharienne, dans une région fictive où une grande partie de la population est infectée par un virus qui la transforme en zombie. Le personnage principal est un enquêteur blanc chargé de nettoyer la zone et de sauver la population locale. Là, vraiment, on sent que personne n'a réfléchi au message !
Pour autant, l'afrofantasy, qui s'inspire des mythes, légendes, cosmogonies et cultures africaines pour créer des récits, est un genre qui commence peu à peu à émerger. Je peux notamment citer le jeu Tales of Kenzera : ZAU, sorti en 2024, dans lequel on incarne un jeune chaman confronté à la perte de son père. Il y a également Relooted, développé par la studio sud-africain Nyamakop, qui se rapproche des codes de l'afrofuturisme, un genre qui puise dans les cultures africaines et afrodiasporiques pour imaginer des futurs où les expériences noires façonnent le monde. Le joueur est plongé dans un futur proche et doit braquer des musées pour restituer des œuvres spoliées pendant la colonisation. Ces narrations, bien qu'encore minoritaires, fleurissent de plus en plus sur la scène vidéoludique ! »
Propos recueillis par Gaëlle Desnos
1 Un « token » désigne une personne issue d'un groupe minoritaire incluse principalement pour donner l'impression de diversité plutôt que pour ses compétences réelles.
-
Changer les règles du jeu vidéo
6 septembre, par Adri Ciambarella, Alex Pommatau — Le dossierS'il y a bien quelque chose que certains droitards et gauchos ont en commun, c'est un mépris pour l'art vidéoludique. Source intarissable de paniques morales pour les un·es, outil de propagande américaniste pour les autres, le jeu vidéo concentre critiques et fantasmes de tous bords. Le président Macron lui-même n'a pas pu résister à la tentation des vieux clichés condescendants lorsqu'en 2023, pendant les révoltes suite au meurtre de Nahel par la police, il avait lancé à l'adresse des manifestant·es : « On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. » Alors, un fléau social qui empoisonne les jeunes esprits, le jeu vidéo ? Rappelons d'abord que c'est une industrie qui pèse lourd : 187,7 milliards de dollars au niveau mondial en 2024, 5,7 milliards d'euros en France – soit davantage que le box-office du cinéma. Il paraît même que notre pays est « une terre de studios de développement avec 600 studios et 1 257 jeux en cours de production » en 2023 et que 38,3 millions de français·es sont des gameur·euses – adultes comme enfants – soit 70 % de la population. Ça fait beaucoup d'intoxiqué·es.
Alors d'accord, comme tout art opérant à système capitaliste constant, l'industrie du jeu vidéo brasse des enjeux à coups de milliards, met aux prises salarié·es et patron·nes dans de rudes conflits sociaux, agrège des communautés hétéroclites. Eh oui, certains joueurs collent tout à fait à l'archétype du geek mascu d'extrême droite que vous vous imaginez. Les campagnes de harcèlement en ligne – misogynes, racistes – vont bon train et les héroïnes hypersexualisées de (au hasard) League of Legends continuent d'être populaires. Mais des poches de résistances existent... et s'organisent. Des joueur·euses et acteur·ices du secteur se regroupent et se soutiennent. Même certains studios tout-puissants ne peuvent plus totalement feindre de les ignorer : il leur faut désormais composer avec ces voix dissonantes qui réclament d'autres récits, d'autres corps, d'autres façons de faire.
Dans notre podcast Gaming et politique1, c'est à ces voix que nous donnons la parole, pour analyser ensemble, les ressorts politiques de cet étrange objet culturel qu'est le jeu vidéo. Et pour CQFD, nous avons accepté de concocter un dossier spécial sur cette industrie, traversée par des mouvements contradictoires, et de plus en plus bousculée par sa base.
Adri Ciambarella et Alex Pommatau
1 Disponible sur Spectre Média, Deezer, Arte Radio.
-
Hausse des droits de douanes : le capitalisme en crise
6 septembre, par Léo Michel — Baptiste Alchourroun, ActualitésFaut-il voir dans le retour fracassant des barrières commerciales un simple épisode de protectionnisme, ou bien le signe d'un basculement plus profond ? Une grille de lecture, héritée des débats du mouvement ouvrier et de Rosa Luxemburg, suggère que les crises du capitalisme et leurs résolutions ne sont pas des accidents mais des moments récurrents de son histoire.
L'accord de Turnberry (Écosse), signé le 27 juillet dernier entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, marque bien plus qu'un épisode de tension commerciale transatlantique. Pour la première fois depuis 1945, l'Europe accepte une mise sous tutelle économique explicite, contractuelle. 15 % de droits de douane sur l'essentiel de ses exportations (contre moins de 5 % en 2022), mais aussi la promesse d'acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie fossile américaine, 600 milliards d'investissements supplémentaires sur le sol états-unien et une hausse des dépenses militaires sous bannière otanienne. Derrière le langage policé de la « coopération transatlantique », une réalité crue s'impose : Washington dicte, Bruxelles s'exécute. Résumer Turnberry, comme l'a fait une grande partie de la presse française, à un simple « revirement protectionniste » apparaît dès lors comme réducteur. L'accord condense les contradictions profondes du capitalisme contemporain. Le libre-échange, matrice de l'expansion capitaliste depuis la fin des années 1970, semble aujourd'hui se retourner contre ses initiateurs.
Crise de la rentabilitéLe régime d'accumulation capitaliste contemporain repose historiquement sur deux vecteurs complémentaires. D'un côté, l'extension géographique des marchés avec l'intégration dans le circuit mondial de centaines de millions de travailleurs et consommateurs issus de la Chine, de l'Inde et de l'Europe de l'Est. De l'autre côté, l'intensification de la production, appuyée par une diffusion à grande échelle de l'automatisation, de l'informatisation et de formes organisationnelles toujours plus extractives. Cette double dynamique a permis une remontée temporaire du taux de profit dans les années 1990 et 20001 : l'ouverture chinoise a joué un rôle moteur en comprimant les coûts salariaux mondiaux et en élargissant les débouchés. Mais, cette expansion a aussi nourri ses propres limites. La suraccumulation de capital au détriment du facteur travail – seul producteur de valeur – débouche sur des crises de surproduction : les capacités productives excèdent les débouchés, les salaires stagnent ou reculent, et la rentabilité globale finit par s'éroder. Un phénomène que les marxistes connaissent bien et nomment la baisse tendancielle du taux de profit.
Si l'on raisonne à politique inchangée, la tendance sous-jacente reste celle d'une rentabilité déclinanteL'économiste Michael Roberts estime ainsi que le taux de profit américain du secteur non financier a chuté de près de 27 % entre 1945 et 2021. De son côté, Michael Smolyansky, économiste à la Réserve fédérale (FED), a montré que près de 40 % de la croissance des profits des entreprises américaines depuis les années 1980 provient non pas de la dynamique propre du capital productif, mais des politiques monétaires et fiscales – baisse des taux d'intérêt et réduction des impôts sur les sociétés. Autrement dit, si l'on raisonne à politique inchangée, la tendance sous-jacente reste bien celle d'une rentabilité déclinante.
Surgissent alors les réponses politiques libérales, dont l'une des fonctions est de contrebalancer la tendance baissière. Celles-ci permettent d'accroître la mobilisation directe du facteur travail en allongeant, par exemple, la durée de vie active (réforme des retraites) ou en remettant en question les temps de repos (suppression de jours fériés), tout en étendant l'emprise du capital sur de nouveaux champs de valorisation par la privatisation des services publics.
L'hégémonie américaine menacéeAu sein de ce grand mouvement, la montée en puissance de la Chine a constitué un tournant décisif. Loin de se limiter au rôle de simple atelier du monde, le pays est peu à peu devenu un centre technologique à part entière. En 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie, Pékin produisait près de 70 % des batteries électriques mondiales et écoulait davantage de véhicules électriques que les États-Unis et l'Europe réunis. Elle domine désormais l'industrie photovoltaïque et contrôle des segments clés des semi-conducteurs. Ce faisant, une vérité émerge : le libre-échange, au lieu de consolider l'hégémonie américaine, a permis l'ascension d'un concurrent systémique. D'instrument de domination, l'ouverture commerciale s'est muée en menace existentielle pour les intérêts états-uniens et plus largement pour les vieux « centres » capitalistes, l'Europe et le Japon. Voilà qui explique la première vague de réactions à laquelle nous faisons aujourd'hui face, à savoir le retour des barrières tarifaires. Il s'agit ainsi de protéger les entreprises nationales de la concurrence chinoise et de transformer les alliés en marchés captifs. Mais cette protection commerciale n'est qu'un premier mouvement. La reproduction du capital exige d'autres instruments tels que la monnaie.
D'instrument de domination, l'ouverture commerciale s'est muée en menace existentielle pour les intérêts états-uniens et plus largement pour les vieux « centres » capitalistesDepuis 1944 et les accords de Bretton Woods, la monnaie américaine est à la fois étalon international des échanges et réserve mondiale de valeur. Dans les années 1980-1990, l'hégémonie du dollar s'est consolidée grâce à trois vecteurs complémentaires : la financiarisation, la dérégulation et le rôle des institutions internationales. Dans ce cadre, chaque crise devient l'occasion d'un approfondissement de cette centralité. En 2008, dans l'œil du cyclone de la crise financière, née au cœur de Wall Street, la planète entière s'est ruée sur les Treasuries2, perçus comme des actifs sûrs, et le dollar, vu comme monnaie refuge. Mais aujourd'hui, cette fonction impériale du dollar rencontre ses limites. La montée en puissance de la Chine et le développement de systèmes alternatifs signalent un effritement relatif du monopole. En 2023 par exemple, TotalEnergies et la Chine scellaient leur premier contrat de livraison de gaz en yuans à travers la plateforme Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX), spécialement créée par la Chine pour imposer sa monnaie dans ses exportations et importations d'hydrocarbures. Dès lors, si le privilège exorbitant des États-Unis demeure, il semble qu'il ne soit plus indiscuté. D'où la brutalité de la diplomatie économique américaine : pour compenser un avantage structurel menacé, Washington multiplie les dispositifs coercitifs, qu'il s'agisse de barrières commerciales, d'obligations d'achat ou de sanctions.
Socialisme ou barbarieLe libre-échange, qui avait été l'instrument principal de l'accumulation, devient un obstacle.Lorsque ni la guerre commerciale ni la guerre monétaire ne suffisent, reste le troisième pilier : la guerre militaire. En détruisant du capital excédentaire, en ouvrant de nouveaux débouchés, en restructurant les chaînes de valeur, la guerre rétablit temporairement les conditions de l'accumulation. Ukraine aujourd'hui, Taïwan demain3, Proche-Orient en permanence : ces foyers de conflictualité ne sont pas des anomalies mais les moments d'une purge.
Depuis quelques années, tout indique que l'un des points d'orgue de la contradiction capitaliste soit atteint : le libre-échange, qui avait été l'instrument principal de l'accumulation, devient un obstacle. Le capital doit dès lors se recomposer par la guerre commerciale, par la destruction des droits sociaux (autoritarisme, racisme, sexisme), par les manipulations monétaires et par la guerre. Chacune de ces étapes est une réponse à la baisse tendancielle du taux de profit, chacune sans s'y résumer complètement, manifeste l'incapacité du capital à se reproduire spontanément. Cette logique n'implique toutefois pas forcément un effondrement mécanique. Le capitalisme a toujours trouvé des voies de recomposition, aussi brutales soient-elles. Mais il met aujourd'hui à nu sa dépendance absolue : il ne survit qu'en détruisant ce qui le rend possible – le travail humain, la nature, la paix.
La question est donc posée : qui paiera la facture de cette recomposition ? Les peuples, sommés d'accepter précarité, austérité, militarisation ? Ou bien émergera une autre voie, qui refuse la paupérisation et la guerre ? La tâche historique n'est pas de réformer ce système en crise, mais de lui opposer une résolution progressiste qui fasse primer les besoins humains sur la logique aveugle de l'accumulation. Voilà la leçon véritable de cet épisode, et la perspective qui s'impose à quiconque ne veut pas voir l'avenir réduit à la barbarie.
Léo Michel
1 Lire « Rentabilité et profitabilité du capital : le cas de six pays industrialisés », Arnaud Sylvain, Économie et statistique, 2001.
2 } Bons du Trésor américains, des titres de la dette publique émis par l'État pour se financer.
3 Sur fond de tension entre les États-Unis et la Chine, le risque d'une invasion de Taïwan par la Chine pèse sur l'île.