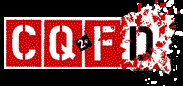Accueil > Agenda > CQFD, journal de critique sociale
Articles
-
Finie la bamboche pour les gauchistes ?
7 février, par Émilien Bernard — BouquinÔ lord, on parcourt un livre verre de pif à portée de main, et voilà qu'au fil des pages on se surprend à regarder ledit verre d'un œil suspicieux. Ne serait-il pas un frein à nos velléités d'insurrection ? C'est en tout cas ce que pensaient pléthore de théoriciens anars de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Avec de solides arguments. Le point de départ du passionnant livre de Mathieu Léonard, Sobres pour la révolution.
Cela peut sembler contre-intuitif. Voire rabat-joie. On pensait que tout le monde rêvait de trinquer au champagne sur une barricade enflammée dans les jardins de l'Élysée. Eh bien non. Dans le passé tout du moins. Ce que montre Sobres pour la révolution – les anarchistes contre l'alcool (Nada, 2026), de l'ami et camarade CQFDien Mathieu Léonard.
Remontons le temps en titubant. Le XIXe siècle a vu l'alcoolisme exploser, avec des chiffres vertigineux : de 1830 à 1900, la consommation d'alcool annuelle est passée de 15 à 35 litres d'alcool pur par personne. Pour principaux soiffards, les classes populaires. Et les penseurs libertaires de faire un constat : la « pieuvre alcool » n'est plus seulement le « symptôme des maux sociaux » (exploitation par les patrons = refuge dans la boutanche), mais « cause profonde du frein à la marche vers la liberté », résume Mathieu Léonard. Jusqu'à l'anarchiste illégaliste Étienne Monier, membre de la bande à Bonnot, qui au moment de monter sur l'échafaud refuse le verre de rhum habituellement offert au condamné : « Je ne veux pas m'alcooliser ». « Prophylaxie ultime ! », s'exclame l'auteur.
Une tendance qui n'est pas du goût de tout le monde. Les discours portant sur « le déterminisme biologique » de l'alcoolisme ou relevant du camp néo-malthusien (pas de progéniture pour les adeptes de la picole) prennent vite du plomb dans l'aile. Il faut dire que la prohibition en terre ricaine, imposée par des ligues de vertu réacs, montre qu'interdire l'alcool ne fait que le rendre plus attirant – « Nulle part ailleurs on ne rencontre autant d'ivrognes que dans les villes acquises à la prohibition », souligne Emma Goldman, militante anarchiste russe. Dans le même temps, nombre d'anars s'insurgent face au mode de vie prôné : « [Les anarchistes individualistes] veulent l'ivresse, non point la tristesse de la vie », s'écrie Lucien Ernest Juin.
La Seconde Guerre mondiale et « l'extermination de groupes jugés inférieurs par la biopolitique nazie » mettent un point quasi final aux idéaux de lutte libertaire sobre. Hormis dans quelques territoires « libérés », à l'image du Chiapas néozapatiste où règne une « loi sèche » en partie propulsée par des femmes.
Morale de l'histoire : si libération de la bouteille il y a, ce sera en s'attaquant aux causes profondes de l'alcoolisme, à savoir l'exploitation de la main-d'œuvre sous la houlette du capitalisme vampire. Quant à ma propre conviction, elle est limpide : la révolution sera anisée ou ne sera pas. Avec modération…
Émilien Bernard -
Venezuela : dans les serres de l’empire
7 février, par Gaëlle Desnos — Quentin Dugay, ActualitésL'attaque du 3 janvier à Caracas est déjà passée hors des radars médiatiques. Trump a changé de sujet, le monde a suivi. Mais le Venezuela, lui, continue de ramasser les miettes de lui-même.
« Des amis de Fuerte Tiuna m'ont décrit des craquements dans le ciel, des colonnes de fumée rouge et une odeur âcre de tirs. » Le 3 janvier, Carmen* a passé la journée scotchée sur son téléphone, textotant frénétiquement ses proches pour s'assurer qu'ils étaient hors de danger. Quelques heures plus tôt, vers 2 heures du matin, des bruits d'explosion ont brutalement déchiré le ciel de Caracas, plongeant le sud de la capitale – autour de la zone militaire et résidentielle de Fuerte Tiuna – dans le noir complet. Les amis de Carmen « ont fui leur appartement à trois sur une moto, à l'aveugle au milieu du chaos ». Par peur d'une pénurie, les habitants du quartier se sont massés devant les commerces et les stations-service. Rapidement, la rumeur circule que le président Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, auraient été capturés… Dans l'après-midi du 3, la vice-présidente Delcy Rodríguez finit par confirmer : le couple présidentiel a été enlevé par les forces armées américaines.
Aussitôt, la presse internationale, grisée, déroule ses habituels récits calibrés façon blockbusters hollywoodiens. Des qualificatifs tels que « spectaculaire », « chirurgical », « hors-norme » viennent écraser la réalité crue d'une attaque ayant laissé derrière elle une centaine de morts. Pour autant, le fracas entendu cette nuit-là à Caracas ressemble moins au bruit d'un régime qui s'effondre qu'à une conquête impérialiste d'un genre nouveau. Car Trump a obtenu la tête de Maduro, tout en veillant à laisser intact l'appareil d'État. Ainsi, il n'a pas fait tomber le régime maduriste : il l'a acquis.
Malaise national« Le calme plat. Le silence total. » Les jours qui ont suivi l'attaque, Rodrigo, étudiant en architecture, décrit un pays en train « d'encaisser ». Nuits désertées, boutiques fermées avant l'heure, écoles vides… Un climat pesant, dans lequel la population n'évolue plus qu'en rasant les murs, exacerbé par des contrôles policiers intempestifs. « Ça existait déjà avant, mais la fouille des téléphones à la recherche de messages incriminants s'est vraiment accentuée après le 3 janvier », témoigne Luisa*, une jeune prof de Caracas. Dans la foulée de son investiture, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a approuvé l'« état de trouble extérieur », un régime d'exception de 90 jours permettant – entre autres – aux autorités de traquer toute personne soupçonnée de promouvoir l'attaque des États-Unis. Pour Rodrigo, ce tour de vis se justifie par « la présence potentielle d'agents américains sur le territoire après ce qui s'est passé ». Mais les crispations du pouvoir ont surtout pour effet de prendre en tenaille une population déjà « très anxieuse », selon Luisa.
Trump a donc besoin d'une figure à la fois prête à composer avec lui et capable de rallier les troupes sur placeEn effet, l'offensive étatsunienne vient s'ajouter aux tensions d'une société vénézuélienne à couteaux tirés, entre soutiens au régime et anti-chavistes. Depuis quinze ans, chaque grand mouvement populaire, durement réprimé, sert de tribune aux leaders de l'opposition pour exiger le départ de Maduro, nourrissant les angoisses des bases chavistes. « Même si les chavistes peuvent aussi se montrer critiques du pouvoir, dans un pays aussi fracturé, où la police est inefficace, un renversement du régime réveille la peur des vengeances interpersonnelles, analyse Fabrice Andréani, chercheur et spécialiste du Venezuela. Imagine : la personne proche du parti qui gère la distribution alimentaire et qui a refusé de servir ceux qu'elle a vu manifester avec l'opposition… Elle flippe qu'on vienne la chercher ! » Depuis l'attaque du 3 janvier, Luisa se dit inquiète, même si, pour l'instant, elle constate une sorte de « trêve silencieuse ».
Une opposition à triste figureMaduro entre les mains de juges new-yorkais, María Corina Machado ne cache pas sa joie. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour adresser ses plus vibrantes flagorneries à Trump1, dans l'espoir, sans doute, d'obtenir de lui le geste décisif qui l'installerait sur le trône. C'est que depuis 2023, Machado est la figure de l'opposition qui s'était imposée au Venezuela. Fervente anticommuniste, son lourd passé politique anti-chaviste – en 2002, elle prenait part au putsch avorté contre Hugo Chávez – la rend particulièrement hargneuse envers l'ancien et l'actuel président. Son filon : la re-démocratisation du pays et le retour des huit millions de migrants partis depuis 2014. Mais la libéralisation de l'économie – déjà bien entamée par Maduro depuis quelques années – reste sa marotte favorite.
« L'opposition que Machado prétend représenter est bien plus plurielle qu'elle »« Le pouvoir maduriste l'a érigée en anti-héroïne de la révolution, alors mécaniquement, une partie du pays s'est agrippée à elle, affirme Fabrice. Quand le mot “socialisme” finit par rimer avec misère, répression, prison, torture ou exil, le capitalisme libéral “à l'occidentale” prend des airs de salut. » Mais, selon lui, « l'opposition que Machado prétend représenter est bien plus plurielle qu'elle ». Au vu des scores électoraux passés de Chávez-Maduro et des résultats actuels de l'opposition, le camp Machado bénéficie sans aucun doute de votes issus des rangs usés du chavisme. Quant à son tropisme pro-américain, il laisse sceptique jusque dans ses propres soutiens. Marga, une Vénézuélienne de la diaspora, résume ce malaise : « J'aime bien María Corina Machado parce qu'elle tient tête au pouvoir. J'ai voté pour son candidat à la dernière présidentielle2. Mais sa proximité avec les États-Unis et Trump me dérange. »
Le président américain l'a d'ailleurs bien compris. Dès le 3 janvier, cruel, il lâche : « C'est une femme très gentille, mais elle n'a pas de soutien interne et n'est pas respectée dans son pays. » Car au Venezuela, au-delà des sondages, le « respect » se jauge aussi du côté des hommes en armes. D'abord, les « colectivos » : ces groupes civils armés hérités des guérillas urbaines des années 1960-1980 sont des alliés historiques du chavisme. Ensuite, l'armée régulière : loyale au régime depuis que Chávez l'a replacée au cœur de l'État. Enfin, les guérillas colombiennes : implantées de part et d'autre de la frontière, elles sont les assurances vie assumées du pouvoir. Ces deux derniers acteurs contrôlent une partie des régions où se trouvent les mines et terres rares (or, coltan, cobalt, etc.) que Trump convoite avec gourmandise. « Le président américain sait qu'aucune de ces forces ne respecte Machado, analyse Fabrice. La propulser au pouvoir l'obligerait à garantir sa survie par un engagement militaire au sol. Mais sa base MAGA l'a élu sur une promesse de “paix”, contre l'enlisement dans des guerres sans fin. » Trump a donc besoin d'une figure à la fois prête à composer avec lui et capable de rallier les troupes sur place. Une figure du sérail peut-être ?
Double face« Après le choc, le peuple s'est mobilisé pour soutenir Delcy Rodríguez et défendre la souveraineté du Venezuela ! » tient à souligner Rodrigo. La présidente par intérim et ancien bras droit de Maduro paraît en effet vouloir se poser en ultime rempart entre l'impérialisme américain et son pays. Pourtant, dès qu'on suit la piste du pétrole, son positionnement semble bien plus ambigu.
Au Venezuela, jusqu'à il y a peu, l'État détenait le monopole de la production des hydrocarbures, ainsi que l'a voulu la loi Chávez de 2001. Les entreprises étrangères restaient cantonnées à des contrats de service, tout au plus à des parts minoritaires dans des sociétés mixtes contrôlées par l'entreprise pétrolière publique (PDVSA). Mais en 2020, alors que la production est au plus bas et que les sanctions étatsuniennes font sentir leurs effets, Rodríguez pousse une nouvelle formule : « les contrats de participation productive ». « Cela permet qu'un partenaire privé finance et opère des projets pétroliers, puis se rémunère en récupérant une part de la production (jusqu'à 65 %). Sur le papier, ce ne sont pas des concessions, mais dans les faits, ça y ressemble fortement ! Et avec un flou juridique face à la loi de 2001 », résume Fabrice. Et quand c'est flou… Les investisseurs ne voient que le loup. Résultat : malgré les récentes injonctions de Trump à aller lui chercher l'or noir vénézuélien, les pétroliers américains traînent des pieds, de peur qu'un retournement politique ne vienne ressusciter la loi Chávez. Delcy Rodríguez s'est dès lors engagée à faire adopter une réforme destinée à lever les ambiguïtés et sécuriser ce type de contrat. A-t-elle vraiment le choix ? Difficile à trancher. Mais le rêve bolivarien, lui, semble bel et bien s'être noyé dans un puits de pétrole et de compromis.
Gaëlle Desnos* à sa demande le prénom a été modifié.
1 Après avoir dédié son prix Nobel de la paix à Trump, María Corina Machado lui remet en main propre la médaille lors d'une rencontre à la Maison Blanche le 15 janvier dernier.
2 Déclarée inéligible par le pouvoir, elle n'a pas pu se présenter aux présidentielles 2024. Elle a néanmoins marrainé un vieux diplomate du nom de Edmundo González Urrutia.
-
« La mère des batailles contre le libre-échange »
7 février, par Livia Stahl, Niel Kadereit — Élias, Le dossierLe 21 janvier dernier, le Parlement européen a suspendu le traité de libre-échange UE-Mercosur. Morgan Ody, coordinatrice générale de La Via Campesina, analyse ce coup d'arrêt après 26 ans de négociations et de contestation paysanne qu'il cristallise. Entretien.
Avec 51 autres membres de la Confédération paysanne, vous avez été placée en garde à vue le 14 janvier dernier pour votre participation à une manifestation contre l'accord avec le Mercosur. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'il s'est passé ?
« 52 paysans et paysannes, en garde à vue, ce n'était jamais arrivé à la Confédération paysanne, même du temps des fauchages de plantations d'OGM. Nous venions protester contre l'accord avec le Mercosur, mais aussi contre le système d'aide au secteur agricole dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte, en Guadeloupe et en Guyane. Ce dernier favorise très largement les grands planteurs blancs de canne à sucre et de bananes et exclut la quasi-totalité des petits paysans, souvent noirs. Cette arrestation était scandaleuse et reflète l'escalade dans la répression et la criminalisation des syndicats. On nous a accusé de violences et de dégradations, mais concrètement la seule chose que l'on peut nous reprocher c'est d'être entrés sans autorisation dans la cour du ministère de l'Agriculture et d'y avoir mis des autocollants. »
D'ailleurs, vous racontiez que les policiers n'étaient pas très à l'aise avec votre détention...
« Oui, car ils ont vu des vidéos de l'action et ont constaté qu'il n'y a eu ni violences ni dégradations. Aussi, évidemment parce qu'il y a un traitement différentiel de la police, qui n'agit pas de la même manière selon qu'elle se retrouve face à des agriculteurs ou à des jeunes des quartiers populaires, surtout quand ils sont racisés. Nous sommes mieux traités parce que nous sommes majoritairement blancs et de bons travailleurs et travailleuses aux yeux des policiers.
Nous ne sommes pas contre le commerce international, mais nous pensons qu'il doit être internationalistePour autant, les paysans ne constituent pas un groupe homogène pour l'État, qui ne traite par exemple pas de la même manière la Confédération paysanne que la FNSEA. Lorsque la veille, le 13 janvier, les agriculteurs et agricultrices de ce syndicat, pourtant de moins en moins majoritaire, ont déversé 30 tonnes de pommes de terre devant l'Assemblée nationale, le gouvernement leur a déroulé le tapis rouge. Je ne veux pas dire par là qu'ils auraient dû aller en garde à vue, mais cela montre bien un double standard. »
Quelques jours plus tard, le 21 janvier, le Parlement européen a voté la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la régularité de ce traité, ce qui suspend son processus de ratification. Vraie victoire ou simple répit ?
« C'est vraiment une victoire commune des paysans et paysannes d'Europe et d'Amérique latine ! Lorsque nous avons reçu la nouvelle, mes collègues du Brésil et d'Argentine ont sauté de joie. Nous allons maintenant défendre cette décision : la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le gouvernement allemand peuvent imposer une application provisoire de l'accord dès les mois de mars, et il n'en est pas question. Ce serait vraiment le pire des scénarios, mais dans ce cas-là, la colère des organisations agricoles en Europe décuplerait.
Ça fait 26 ans qu'on essaie de nous l'imposer et ça fait 26 ans qu'on résisteL'autre scénario serait que le vote des parlementaires soit respecté, ce qui nous ferait gagner entre six mois et deux ans, le temps que le CJUE se prononce sur la conformité de l'accord avec les textes européens. Et quand bien même elle le jugerait conforme, il faudrait un nouveau vote sur le fond par le Parlement européen. Or le 21 janvier, on a vu qu'il n'y a pas de majorité garantie en faveur du traité. De toute façon, cela fait 26 ans qu'on essaie de nous l'imposer et ça fait 26 ans que l'on résiste. Pour nous, c'est vraiment la mère des batailles pour faire changer profondément la politique commerciale de l'Union européenne. Ce qu'il se passe avec le Mercosur, ça montre bien que la Commission européenne s'entête dans une stratégie de libre-échange, qui n'a plus beaucoup de soutien populaire, et qui même auprès des députés et des gouvernements fait de moins en moins consensus. »
Quel rôle ont joué les mobilisations en Europe dans la suspension de ce traité ?
« Nous nous sommes battus pour arracher cette suspension, à dix voix près, en nous rendant au Parlement pour convaincre des députés allemands, tchèques et chypriotes de voter pour la saisine de la CJUE. Seule la gauche s'est clairement positionnée contre le traité. Dans tous les partis, les députés étaient divisés en fonction de leur nationalité et du poids de l'agriculture dans leur pays. Alors que l'ensemble des députés français ont voté pour sa suspension, ils se sont parfois retrouvés en minorité dans leur groupe. C'est le cas par exemple pour les macronistes qui siègent au sein du parti libéral Renew Europe. Au-delà de ce travail de plaidoyer, les mobilisations des organisations agricoles dans les rues, en France, en Irlande, en Grèce, en Roumanie, en Pologne ou encore en Belgique ont bien pesé en mettant la pression sur les élus. »
Comment expliquez-vous que le secteur agricole et paysan arrive à remporter des batailles contre ces grands accords de libre-échange là où d'autres secteurs de l'économie n'y arrivent pas ?
« Cela s'explique en partie par nos mobilisations, mais aussi parce que de nombreux pays sont très réticents à l'idée de démanteler leur politique de soutien à l'agriculture. Les conséquences sociales peuvent être désastreuses, à la fois pour les paysans et paysannes, mais aussi pour la sécurité alimentaire de la population. À chaque fois qu'il y a dérégulation des politiques publiques agricoles, il y a des phénomènes de fluctuation des prix : ou bien ils chutent, ou bien ils connaissent une inflation énorme, et parfois les deux se succèdent. Pour cette raison, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) échoue systématiquement à conclure de grandes négociations sur l'agriculture depuis 2001. »
Et c'est pour contourner cette difficulté de mettre en place des accords mondiaux que l'Union européenne multiplie les accords bilatéraux, comme celui avec le Mercosur ?
« Ça, et le contexte international. L'Union européenne s'est construite sur les bases du libre-échange, avec la conviction que c'est par l'agrandissement des marchés qu'elle va se développer et se renforcer. Pour ce faire, l'oligarchie européenne a tout misé sur ses exportations agricoles.
L'autre pilier de la souveraineté alimentaire, c'est le contrôle démocratique des ressources, des terres et de l'eau par les populationsMais aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, le marché américain est en train de se refermer. Ça la fait complètement paniquer, et elle tente par tous les moyens de trouver de nouveaux débouchés, dont le Mercosur. Ce n'est pas la bonne méthode selon nous pour garantir notre autonomie. »
Au contraire, que défendez-vous à La Via Campesina ?
« Nous défendons le principe de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples à définir leurs propres systèmes alimentaires, en donnant la priorité à la production locale, à la durabilité et au bien-être des populations. Ce principe se base sur le droit à mettre en place des barrières douanières et des barrières non tarifaires comme des normes, qui peuvent être sociales, sanitaires, environnementales ou autres. En ce sens, à La Via Campesina nous sommes protectionnistes, c'est-à-dire que nous considérons que la protection des marchés est légitime et nécessaire. Mais à la différence d'un protectionnisme nationaliste ou opportuniste, nous reconnaissons ce droit pour tous les pays, contrairement à la FNSEA. Eux exigent l'imposition de normes pour protéger les marchés intérieurs européens, mais dans le même temps, ils maintiennent qu'il faut ouvrir tous azimuts les marchés des autres pays. Nous ne sommes pas fondamentalement contre le commerce international, mais nous pensons qu'il doit être internationaliste. »
Et ce serait quoi une politique commerciale internationaliste ?
« Une politique qui reconnaît le droit de faire des stocks et de définir des prix plancher [voir encadré]. Un autre outil qui nous paraît intéressant, ce sont les contrats de pays à pays. Par exemple, le commerce de céréales passe par les bourses de Chicago, de Paris et d'ailleurs. Il fait l'objet de spéculations ce qui engendre des prix très volatils et beaucoup de profits pour les entreprises financières. À la place, nous sommes pour la mise en place de contrats à long terme entre les pays qui sont structurellement excédentaires et les pays qui sont structurellement importateurs, avec des prix stables indexés sur les coûts de production. Cela permettrait de sécuriser les pays importateurs afin qu'ils ne fassent plus face à des pics de spéculation comme ça a été le cas en 2008 ou plus récemment en 2022. »
Cela implique donc de sortir de l'Organisation mondiale du commerce ?
« Oui c'est une revendication centrale de La Via Campesina, dès sa création en 1993. À l'heure actuelle, l'OMC empêche de mettre en place de vraies politiques d'intervention sur les marchés agricoles. Résultat : ce sont les grands acteurs du marché qui mènent la danse et achètent au plus bas prix leurs productions aux paysans, pour les revendre le plus cher possible aux consommateurs. Dans le fond, même des gouvernements qui ne souhaitent pas changer de modèle agricole et veulent maintenir une agriculture industrielle et productiviste ont intérêt à s'assurer des exportations stables à long terme et des importations à des prix qui correspondent aux coûts de production pour ne pas couler les producteurs nationaux. En fait, ce sont des politiques qui sont très largement soutenues par les populations pour des raisons de souveraineté et de sécurité alimentaire. Ce dont beaucoup de gens n'ont pas conscience, c'est que la plupart des pays du monde ont une capacité à produire leur alimentation, à condition qu'elle corresponde aux caractéristiques du territoire. »
Il y a des gouvernements avec lesquels vous travaillez sur ce type de réforme ?
« Oui, nous faisons un travail intéressant avec le gouvernement colombien qui partage cette volonté d'avoir une approche renouvelée des réformes agraires plus respectueuses des populations autochtones. Le nouveau gouvernement mexicain et celui d'Afrique du Sud nous appuient également. Les velléités impérialistes de Trump ont ravivé l'intérêt de nombreux pays de participer à une réflexion internationale pour décider de l'utilisation de leur territoire. Mais la politique commerciale n'est que l'un des deux piliers de la souveraineté alimentaire. L'autre, tout aussi majeur, c'est le contrôle démocratique des ressources, des terres et de l'eau par les populations au niveau local. »
Mais qui sont les méchants exportateurs du Brésil ?
Luiz Zaref, membre de la Coordination nationale du Mouvement des travailleurs sans terre (MST), le plus grand mouvement paysan d'Amérique latine nous éclaire.
« Les paysans du Brésil ou d'Amérique du Sud produisent majoritairement sur les marchés locaux. Ceux qui exportent beaucoup, ce sont les propriétaires de l'agro-industrie sud-américaine. Ce sont ceux qui produisent essentiellement du soja, du maïs et du coton qui veulent vendre davantage en Europe. Ce sont contre eux que vont devoir lutter les agriculteurs européens. Et au Brésil, ce sont les personnes les plus riches du pays : elles possèdent les terres, contrôlent la chaîne de production de bout en bout, et occupent pas moins de la moitié des sièges au Congrès. Naturellement, cela leur permet de bénéficier en plus de larges subventions de l'État brésilien. Il en va de même en Argentine ou au Paraguay. Ce sont eux qui déforestent l'Amazonie, eux qui émettent des gaz à effet de serre et aggravent le réchauffement climatique, eux qui accroissent les inégalités sociales.
Et le Mercosur, qui permettra le développement de la marchandisation des matières premières, notamment nos ressources minières, est tout en faveur de leurs intérêts. Car il concentrera entre leurs mains davantage de bénéfices, donc de terres, de ressources naturelles, et de pouvoir politique.
Au contraire, pour nous, les petits paysans d'Amérique du Sud, le Mercosur sera délétère. L'exploitation à outrance des matières premières se fera au détriment du développement du secteur industriel, alors que notre pays a au contraire besoin de développer son économie interne, de créer des emplois, et d'aller vers la souveraineté alimentaire. En outre, le Mercosur facilitera l'importation de produits laitiers européens, dont les modes de production, plus développés technologiquement, sont bien moins onéreux que les nôtres. Chez nous, la production laitière est fondée sur des fermes familiales, et constitue déjà le secteur paysan le plus pauvre du Brésil. C'est une concurrence intenable. »
Quelles mesures pour un modèle agricole internationaliste ?
Ni libre-échange sauvage, ni protectionnisme patriote : comment sortir de cette (fausse) binarité quand on veut réfléchir à un modèle agricole qui protège les travailleurs de tous les pays, salariés comme petits exploitants ? La Conf et la Via Campesina revendiquent trois mesures phares.
1 Le prix minimum rémunérateur :
C'est le prix minimum auquel chaque produit doit être acheté. Il comprend l'ensemble des coûts de production, à savoir : les charges liées à la production, la rémunération des travailleurs (le salaire et les cotisations pour le chômage, la retraite et la maladie). Aujourd'hui en France, la majorité des paysans ne se paient pas au Smic, ne prennent pas de congés, ne se mettent pas en arrêt maladie et, quand elles et ils ont du chômage, il est insuffisant. Pour rendre ce métier un tant soit peu vivable dans un monde capitaliste (en attendant la révolution), il faut commencer par la thune.
2 Le prix minimum d'entrée :
Maintenant qu'on a augmenté nos prix d'achat nationaux au « prix minimum rémunérateur », comment éviter que l'agro-industrie et les grosses chaînes de distribution aillent se fournir ailleurs ? Par le « prix minimum d'entrée » sur le territoire : il rehausse le prix d'achat des produits étrangers au niveau de celui des denrées produites en France. Ce qui donne aux producteurs étrangers une marge de manœuvre pour améliorer leurs conditions de travail, en toute souveraineté. Rien à voir donc avec les fameuses « clauses miroirs » des traités de libre-échange actuels, qui leur dictent de manière impérialiste « la bonne manière de produire ». Quand la concurrence débridée et les tarifs douaniers écrasent leurs prix de vente, ce prix minimum d'entrée permet un nivellement par le haut pour les exportateurs de tous les pays. La solidarité entre les peuples quoi. Et en prime, comme la concurrence entre produits nationaux et étrangers ne se fera plus sur les prix, elle se fera sur d'autres critères autrement plus progressistes, comme la qualité des produits, ou le mode de production mis en avant. La bonne heure !
3 Le prix minimum d'intervention :
Enfin, en cas d'offre anormalement excédentaire d'un produit sur le marché international, l'État garantira le rachat des surplus de stocks aux producteurs à un « prix minimum d'intervention ». S'il existe déjà aujourd'hui, son montant est si faible qu'il ne dépasse jamais celui du marché, quelle que soit la crise. Son montant doit être relevé. Mais attention : pour empêcher les petits malins, fans de monocultures intensives et pas chères, d'abuser de ces rachats garantis, cette mesure s'accompagnera d'un contrôle de l'offre. Pas de justice sans cadre.
[Niel Kadeiret et Livia Stahl]
-
Classe paysanne : unie mais à quel prix ?
7 février, par Malo Toquet — Élias, Le dossierCet hiver, le secteur agricole s'est mobilisé contre la gestion de l'épidémie de dermatose et le traité du Mercosur. L'occasion de voir marcher côte à côte des militants de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale. Alliance bancale ou solidarité de classe bienvenue ? On est allé le leur demander.
Une trentaine d'engins agricoles bloquent l'étroit pont à la sortie de Port-Saint-Louis-du-Rhône, en pleine Camargue. Dans le froid de cette matinée de janvier, les automobilistes sortent de leurs véhicules, arrêtés sur la petite route départementale. « Bravo les gars, lâchez rien ! » lance l'un d'entre eux, en attendant que le cortège redémarre, escorté par un peloton de gendarmerie. Les agriculteurs sont venus protester contre l'abattage de leurs troupeaux et la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. De l'autre côté, les camions de CRS et véhicules blindés, les fameux Centaures, sont à l'affût, prêts à faire évacuer la route. « C'est complètement disproportionné », se plaint un agriculteur de Tarascon, arrivé sur place à 5 heures du matin.
De la répression policière, des blocages et des slogans contre la mondialisation : à première vue, CQFD était dans sa zone de confort. Sauf que... pas vraiment. Les drapeaux tricolores, les stickers jaunes et noirs et autres « JORDAN 2027 » écris à la craie sur un tracteur rappellent que l'action est organisée par la Coordination rurale (CR), deuxième syndicat agricole de France et proche du Rassemblement national (RN). Et pour rajouter de la confusion à la confusion, on a aussi vu, ces dernières semaines, l'arbre sur fond jaune des camarades syndiqués de la Confédération paysanne flotter sur les blocages au côté des bonnets, jaunes eux aussi, de la CR. Mais qu'est-ce que la Conf' est venue faire dans cette galère ?
Une mobilisation nodulaire contagieuse« Le mouvement agricole de cet hiver s'est vraiment enflammé avec l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) », analyse Stéphane Galais, porte-parole national de la Conf'. La DNC est une maladie virale des bovins, très contagieuse. Pour la contenir, le gouvernement a fait le choix de procéder à l'abattage systématique des troupeaux dans lesquels un cas aurait été détecté. Deux syndicats agricoles protestent contre cette gestion de l'épidémie à laquelle ils opposent un abattage partiel assorti d'une vaccination : la CR et la Conf'. Un simple « concours de circonstances, justifie Stéphane Galais. Concrètement, on s'est retrouvé, les deux syndicats, dans les mêmes fermes où les services vétérinaires allaient procéder à l'abattage total. »
à la Conf', beaucoup expliquent ne pas vouloir juger le positionnement de territoires qui ne sont pas les leurs, et dont ils ne connaissent pas l'historique des luttesIl semble que ce soit lors de ces premiers abattages, qu'une spontanéité dépassant le cadre strictement syndical se soit créée. « Dans les départements avec des cheptels à sauver, on ne se pose pas la question des orientations syndicales, explique Thomas Barthout, porte-parole de la Conf 86 (Vienne). On va soutenir les éleveurs en difficulté, syndiqués de la Conf', de la CR, non-syndiqués, représentants politiques… » Même son de cloche du côté de Caroline Lecanuet présidente de la CR 13 (Bouches-du-Rhône) : « Il y a des dynamiques d'urgence qui sont supra-syndicales. On est tous d'accord pour défendre notre outil de travail. Devant l'abattage de son troupeau, un adhérent de la CR ou de la Conf ' a le même problème. Même les membres de la FNSEA y sont allés, quitte à se retrouver en porte-à-faux avec leur syndicat. »
Le consensus s'est étendu, dans la foulée, au mouvement de protestation contre le Mercosur, alors même que les directions syndicales restent prudentes sur un investissement conjoint. Stéphane Galais rappelle les « fractures idéologiques énormes » : « À aucun moment la Conf' nationale n'a appelé à converger avec la CR. » Idem pour la CR, qui publiait en 2023, dans la foulée des mobilisations contre les mégabassines, un communiqué au vitriol dans lequel elle écrivait : « La Confédération paysanne ne représente pas le monde paysan, mais travaille à sa destruction. » Mais, côté écolos et antifas, le message ne semble pas si clair, ou trop tardif. En décembre, un texte1, dénonçant une ligne politique naïve, voire confusionniste, de la part de la Conf', se met à circuler sur des réseaux d'information autonomes.
D'un côté, une mobilisation populaire qui réunit des individus mais aussi des organisations qui ne sont pas toutes acquises aux thèses de gauche ? De l'autre, des syndicats qui hésitent sur la marche à suivre ? La dynamique n'est pas sans rappeler un certain nombre de précédents mouvements populaires en France... Des Gilets jaunes aux Antivax.
La Coordination rurale : le confusionnisme sauce paysanneAlliance avec le diable ou mouvement spontané et populaire ? Une grande partie du flou tient au caractère confusionniste de la CR. Sur leur site internet, rien n'indique directement une quelconque adhésion à la droite réactionnaire. Dans leur section « Qui sommes-nous », les quatre valeurs mises en avant sont « la solidarité, l'indépendance, l'appartisanisme et la responsabilité ». Sur le papier, un discours somme toute assez classique pour un syndicat. Fondée en 1991 sous la forme d'un mouvement, la CR naît historiquement d'une contestation de la Politique agricole commune européenne (PAC), rappelle Christian Croizet, ancien porte-parole de la Conf 47 (Lot-et-Garonne) : « Face à la passivité de la FNSEA, une coordination s'est créée dans le sud-ouest avec des militants de la Confédération paysanne, du Mouvement de défense des exploitants familiaux (Modef) proche des communistes, des dissidents de la FNSEA et des paysans non syndiqués. » Mais les déclarations répétées d'appartisanisme et d'apolitisme2 des dirigeants successifs de la CR ont de plus en plus de mal à cacher la misère : l'effritement, voire l'hémorragie, des idées et des militants de gauche au sein du mouvement (devenu syndicat en 1994), le fait glisser toujours plus vers la droite. Caroline Lecanuet, continue néanmoins de s'en défendre. Pour elle, la présence importante de sympathisants d'extrême droite serait contextuelle : « Le monde agricole est plutôt marqué à droite, voire à l'extrême droite, c'est un fait. Donc c'est logique qu'on ait des membres d'extrême droite ! Mais ça n'empêche pas qu'on ait des sympathisants républicains ou de gauche. » Sur le site de la CR, on continue notre lecture du « Qui sommes-nous » : « Des positions bâties non sur une idéologie ou un programme partisan, mais sur le bon sens. » Autrement dit, « ni de droite ni de gauche » ? Le bingo du confusionisme par excellence.
Thomas Barthout, de la Conf 86, analyse la popularité de la CR parmi les agriculteurs : « On est face à un milieu agricole qui est fortement en difficulté. Chacun cherche à trouver de la ressource et de la force pour sauver sa ferme. La Coordination rurale propose des actions fortes qui répondent au désarroi dans lequel sont beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup s'y reconnaissent, car ils y perçoivent un soutien concret dans la manière dont ce syndicat agit. » Une recette qui marche, opine Stéphane Galais : « L'adhésion d'un agriculteur à la CR est rarement basée sur des idées xénophobes mais plutôt par rejet des institutions, de l'État, des syndicats historiques responsables de n'avoir pas agi... La CR apporte souvent des réponses simplistes à des problèmes complexes en désignant par exemple des hommes de paille comme les écolos ou les bobos parisiens. La même recette que le RN finalement. » D'ailleurs, même si les données manquent sur le sujet, l'implantation géographique de la CR ne semble pas se faire au hasard, selon Stéphane Galais : « Elle fait des gros scores dans les zones intermédiaires comme le Sud-Ouest [les zones agricoles les moins fertiles, entre deux massifs montagneux, ndlr]. Ces zones, plus petites, sont très vulnérables quand on est face à un marché dérégulé. Tout le contraire des zones avec des sols très profonds, propices à la culture des céréales à grande échelle, comme le bassin parisien. »
Si on veut bien croire que les adhérents de la CR sont plus divers qu'on ne l'imagine, de l'autre côté du manche syndical, les cadres, eux, sont explicitement réacs. Les derniers dirigeants, Véronique Le Floch et Bertrand Venteau (président en exercice) ne cachent plus leurs sympathies explicites pour le RN. En 2024, sur France Inter, la première saluait le programme agricole du RN, tandis que le second promettait, lors de son discours d'intronisation, de « faire la peau aux écolos ». Venteau n'hésite par ailleurs jamais à réinvestir le répertoire des expressions et actions des Chemises vertes, le comité de défense des paysans des années 1930 connu pour sa tendance fasciste. Quant à l'un de ses mentors, Serge Bousquet-Cassagne, il appelait la députée écologiste Marine Tondelier sur son téléphone personnel en 2023, pour lui lancer, menaçant : « Ma poule, tu t'es encore échappée. Je vais t'attraper et te plumer… »
« Devant l'abattage de son troupeau, un adhérent de la CR ou de la Conf ' a le même problème »Enfin, plusieurs cadres du syndicat ont multiplié les passerelles avec des partis d'extrême droite. Dans la vague de députés RN élus en juin 2022, on compte par exemple Christophe Barthès, ancien vice-président de la CR de l'Aude. Philippe Loiseau, militant historique du syndicat, est, quant à lui, devenu député européen et conseiller de Marine Le Pen sur les questions agricoles. Plus obscur encore, l'actuelle vice-présidente de la CR, Sophie Lenaerts, a été aperçue aux universités d'été 2024 de l'Action française, tandis que Richard Roudier, président la Coordination dans le Gard dans les années 2010, a fondé la Ligue du Midi, groupe identitaire investi dans la campagne d'Éric Zemmour en 2022. Bref un apartisanisme avec un goût nettement rance.
Et outre les coups de boutoir répétés, il règne, parmi les têtes pensantes de la CR, un libéralisme de bon aloi cristallisé par le slogan « Qu'on nous foute la paix ! ». « Ils veulent un agriculteur seul aux manettes, sans aucun droit de regard de la société sur la façon de produire, par exemple sur la question des pesticides, explique Thomas Barthout. C'est assez gonflé quand on pense à l'étendue des aides publiques accordées à leur secteur ! »
Dans la gauche paysanne, une stratégie en ordre disperséDans la Vienne, la question des mégabassines concentre les dissensions entre les sections de la Conf' et de la CR. Des militants antibassines sont fréquemment attaqués par des membres de la Coordination, qui n'hésitent pas à employer la violence physique et les menaces de mort. Suite à l'organisation d'un rassemblement déguisé contre les mégabassines à l'occasion d'Halloween, la CR 86 avait mis sur pied un contre-rassemblement présenté comme une « grande chasse des anti-bassines d'Halloween ». Sur les flyers, un petit cercueil… « S'il doit y avoir des échanges musclés, il y aura des échanges musclés » déclarait le président de la CR86 au journal Vert3. Pas étonnant que pour Thomas Barthout, militant de la Conf' dans la Vienne, il soit hors de question de s'afficher avec eux : « Ça reste un syndicat dans le repli identitaire, corporatiste, libéral, prônant un protectionnisme national. Je n'ai pas milité au Scalp [Section carrément anti-Le Pen, ndlr] pendant des années pour me retrouver sur des barrages avec une orga de fachos qui prône des valeurs identitaires. » S'il reste respectueux des choix des autres sections locales, la confusion entre les deux syndicats dans l'opinion publique l'inquiète : la Conf' pourrait devenir, aux yeux du grand public, responsable des actions de la CR, qu'elle n'a ni commises ni approuvées. Mais au-delà de la com', Thomas Barthout doute de la stratégie qui consiste à laisser le rapprochement se faire : « Le prosélytisme de gauche, certains y vont à fond, mais ça n'a pas porté beaucoup de fruits jusqu'à maintenant. » Et de fait, c'est effectivement la CR qui a principalement bénéficié des retombées politiques des mobilisations de 2024 contre le Mercosur : aux élections agricoles qui ont suivies, en janvier 2025, la CR a remporté la présidence de 10 chambres d'agriculture contre 3 en 2019, là où la Conf' en a gagné seulement 4 contre 2 en 2019. Le tout sur fond de détricotage des normes environnementales, pour le plus grand plaisir de la CR.
Face à la CR, nombreux sont les militants de gauche à penser qu'il faut occuper le terrain et diffuser un discours émancipateur« À la Conf', les sections locales sont souveraines », répètent inlassablement tous les membres de la Conf' que nous avons interrogés. Beaucoup expliquent ne pas vouloir juger le positionnement de territoires qui ne sont pas les leurs, et dont ils ne connaissent pas l'historique des luttes, les équipes en place, ni le contexte politique. En effet, dans nombre de départements, les membres des différents syndicats se retrouvent dans les mêmes institutions. Chambres d'agriculture, commissions Safer, CDOA, CDEPNAF4 et autres obscurs acronymes... « Je siège dans une assemblée qui a pour vocation de trouver des solutions pour les paysans du département dans un contexte d'une infinie complexité, rétorquait Emmanuel Aze, élu de la Conf' à la chambre du Lot-et-Garonne, dans un article publié par Reporterre en mars 2023. Mon mandat n'aurait pas le moindre sens si je l'assumais en cherchant la fracture systématique plutôt que le dialogue. Aucune forme de guerre civile parmi la population n'améliorera ni le sort des paysans ni la situation écologique à laquelle nous devons faire face, par définition, collectivement. » Cette coopération institutionnelle peut aller de la simple coexistence jusqu'à des tentatives d'influence par un travail de long terme, se réjouit Romain Henry ancien porte-parole de la Conf 37 (Indre-et-Loire) : « Si on parle d'économie politique, là, on peut avoir des terrains de discussion. La première motion de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire qui a été proposée au vote par la Coordination rurale, c'était sur les prix minimum garantis et la souveraineté alimentaire, deux notions introduites par la Conf' ! »
Face à la CR, nombreux sont les militants de gauche à penser qu'il faut occuper le terrain et diffuser un discours émancipateur, en particulier auprès d'individus les moins politisés. Elsa, du Syndicat du travail de la terre et de l'environnement (STTE, une section de la CNT), défend les mobilisations au contact : « Chez les ouvriers agricoles, il y a plein de gens sensibles aux discours d'extrême droite. Il faut leur parler ! Parce que si on fait comme s'ils n'existaient pas, ils vont juste se renforcer dans leurs délires. » Il y a même une certaine humilité à adopter selon Martin, arboriculteur dans l'Aveyron : « Les agriculteurs en méthode conventionnelle se prennent beaucoup de mépris dans la gueule. On leur dit : “vous violez la terre !” Mais en leur lâchant ça, on les enferme dans une identité d'ennemie de l'écologie ! Au même moment, la CR ou le RN leur parlent de fierté agricole, et ça marche ! » Martin rappelle qu'à la sortie de la guerre, les agriculteurs ont été poussés à adopter la modernité : « Aujourd'hui, ils sont hyper dépendants et on leur remet sur le dos la responsabilité du modèle productiviste... Il y a une forme de mépris de classe dans cette façon de rejeter la responsabilité sur les agriculteurs plutôt que sur nos choix de société. » Pour lui, ce n'est pas le marché du bio ou de la vente directe qui changera la donne vue la saturation actuelle du secteur. « La consommation est massivement transférée sur les supermarchés depuis les années 1960, c'est ancré dans l'organisation de notre société. Donc si on veut changer la production, c'est toute la chaîne qu'il faut repenser. »
Tout repenser, à commencer peut-être par la répartition du pouvoir dans un secteur où la FNSEA règne encore en maître. Grâce à un système de cogestion et de prime au gagnant dans les chambres agricoles, ce syndicat de grands patrons tient toujours 84 présidences de chambres sur 102. Tout repenser « avec une place pour les salariés et ouvriers agricoles », rappelle Elsa du STTE. Alors qu'ils réalisent plus de 44 % du travail déclaré du secteur, les salariés restent pourtant presque exclus des institutions en raison d'un très faible taux de syndicalisation. Alors aux amis, qui pensent qu'il vaut « mieux être un cochon qu'un fasciste », on y souscrit de bon cœur. Mais sans mobilisation réelle et massive dans la porcherie, le cochon un peu trop puriste risque de finir comme les autres : à l'abattoir.
Malo Toquet
1 Voir « La Confédération paysanne main dans la main avec l'extrême droite », sur le site de Paris-lutte.info (13/01/2026).
2 Sur son site, la CR a publié un communiqué intitulé « Un fois pour toutes, la CR est apolitique ! »
3 Lire « “Traquons les anti-bassines” : dans la Vienne, le syndicat agricole Coordination rurale veut en découdre avec les militants écolos », Vert (30/10/2025).
4 Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, Commission départementale d'orientation de l'agriculture, Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers... Sans déc', vous lisez vraiment les notes de bas de page ?
-
Au sommaire du n°249 (en kiosque)
7 février — Sommaire
Cet hiver, les agriculteurs ont été nombreux à se mobiliser pour tenter de faire entendre leurs voix contre la gestion de l'épidémie de dermatose et le traité du Mercosur. On vous a concocté un dossier spécial agriculture : on y évoque l'entente surprenante entre la Confédération paysanne et la Coordination rurale, puis on s'est entretenu avec Morgan Ody, coordinatrice générale de La Via Campesina, qui nous donne son ressenti après la suspension du traité de libre-échange avec le Mercosur après 26 ans de contestation. Hors dossier, on vous parle du projet bien polluant et loin d'être démocratique des JO d'hiver 2030, qui se doivent se dérouler dans les Alpes. On prend des nouvelles de la situation au Venezuela après l'enlèvement de Nicolàs Maduro et on discute de Tête dans le mur, le bouquin gonzo d'Emilien Bernard, l'un de nos journalistes qui a remonté la frontière murée entre les US et le Mexique.
Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d'aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner...
En couverture : « À l'heure où rugit la campagne » par Mathieu Ossona de Mendez
***
À l'heure où rugit la campagne
– Colères dans les prés, fleurissent, fleurissent – Difficile d'être passée à côté de cette histoire d'accord entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, la zone de libre-échange d'Amérique du Sud. Le schmilblick : l'abaissement des droits de douane entre les deux continents, l'ouverture des marchés du Mercosur aux entreprises européennes, notamment dans l'industrie et les services, et un accès facilité au marché européen pour les gros exploitants agricoles sud-américains.
– Classe paysanne : unie mais à quel prix ? – Cet hiver, le secteur agricole s'est mobilisé contre la gestion de l'épidémie de dermatose et le traité du Mercosur. L'occasion de voir marcher côte à côte des militants de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale. Alliance bancale ou solidarité de classe bienvenue ? On est allé le leur demander.
– « La mère des batailles contre le libre-échange » – Le 21 janvier dernier, le Parlement européen a suspendu le traité de libre-échange UE-Mercosur. Morgan Ody, coordinatrice générale de La Via Campesina, analyse ce coup d'arrêt après 26 ans de négociations et de contestation paysanne qu'il cristallise. Entretien.
***
Actualités d'ici & d'ailleurs
– JO d'hiver 2030 : un conflit ? quel conflit ? – En 2030, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver se tiendront dans les Alpes françaises. Cocorico ! Mené en douce, ce projet est plutôt un concentré de tout ce qui se fait de pire en matière d'atteintes au droit, à la démocratie et à l'environnement. Alors, pourquoi diable ne nous révolte-t-il pas plus ?
– Sur la route du Rojava - Alors que les forces gouvernementales syriennes ont attaqué le Rojava à la mi-janvier après l'annexion des quartiers kurdes d'Alep, les réseaux de solidarité européens avec le Kurdistan ont organisé, dans l'urgence, des convois solidaires vers Kobané.
– Alep : les quartiers kurdes assiégés – Malgré ses engagements à protéger les minorités ethniques présentes sur son territoire, le nouveau gouvernement de transition syrien a envoyé ses troupes assiéger deux quartiers kurdes de la ville d'Alep le 7 janvier dernier. Récit de ce troisième épisode de violences contre les peuples de Syrie.
– Venezuela : dans les serres de l'empire – L'attaque du 3 janvier à Caracas est déjà passée hors des radars médiatiques. Trump a changé de sujet, le monde a suivi. Mais le Venezuela, lui, continue de ramasser les miettes de lui-même.
– « Creuser la folie de l'Amérique trumpiste en mettant en scène mes propres doutes » – En 2024, Émilien Bernard est parti couvrir l'élection présidentielle américaine à la frontière mexicaine, pour le compte de CQFD. Il en a tiré un livre, La tête dans le mur, dans lequel il raconte à la première personne la violence des politiques migratoires, la folie trumpiste et ses doutes face à un monde qui déraille.
– Serbie : la culture dans le viseur – Au sein des milieux culturels serbes mis à mal par des années de dérive autoritaire sous le gouvernement d'Aleksandar Vučić, les voix dissidentes se mêlent aux sifflets du mouvement contestataire.
– Les licenciements de Noël d'un hôtel marseillais – Au pied des marches de la gare, la direction de l'hôtel Marseille Centre Gare Saint-Charles a tenu à marquer les fêtes de fin d'année par une délicate décision managériale en licenciant six salarié·es, tous·tes syndiqué·es. Récit d'un mauvais tour de passe-passe.
– Lettre à Philippe, fervent admirateur de Brigitte Bardot Saint-Trop' – Vous vous en doutez, c'est pas exactement notre spot de prédilection, à la rédac'. Mais le jour des obsèques de Brigitte, on n'a pas pu résister : fallait qu'on passe une tête. Et, oh surprise ! Sous les escarpins, les mièvreries et les photos d'animaux mignons : toujours les mêmes fachos.
– « De quoi le ruisseau est-il la mémoire ? » – Remonter un fleuve à demi bétonné qui traverse le nord de Marseille, c'est la balade que donne à voir le photographe Félix Colardelle dans son le livre photo La Caravelle. On suit un ruisseau malmené par les activités industrielles et l'urbanisme déjanté, hier comme aujourd'hui.
***
Côté chroniques
– Sur la Sellette : Mise à l'amende –En comparution immédiate, on traite à la chaîne la petite délinquance urbaine, on entend souvent les mots « vol » et « stupéfiants », on ne parle pas toujours français et on finit la plupart du temps en prison. Une justice expéditive dont cette chronique livre un instantané.
– Échec scolaire : Conseil de classe : punir les déserteurs – Loïc est prof d'histoire et de français, contractuel, dans un lycée pro des quartiers Nord de Marseille. Chaque mois, il raconte ses tribulations au sein d'une institution toute pétée. Entre sa classe et la salle des profs, face à sa hiérarchie ou devant ses élèves, il se demande : où est-ce qu'on s'est planté ?
– Peine perdue : Familles, je vous hais – Luno intervient bénévolement en prison. Chaque mois, il livre ici un regard oblique sur la taule et ses rouages par quelqu'un qui y passe mais n'y dort pas. Épisode 4 : une pensée pour les familles.
***
Côté culture
– La taille de la norme – À presque 40 ans, Bastien Lambert décide de remonter le temps. Dans son documentaire radio, « Grandir, ou pas... », il interroge proches et médecins sur la façon dont sa petite taille a été perçue, vécue et tentée d'être soignée. Une remise en question sur ce que peut être une quête de « normalité ».
– Finie la bamboche pour les gauchistes ? – Ô lord, on parcourt un livre verre de pif à portée de main, et voilà qu'au fil des pages on se surprend à regarder ledit verre d'un œil suspicieux. Ne serait-il pas un frein à nos velléités d'insurrection ? C'est en tout cas ce que pensaient pléthore de théoriciens anars de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Avec de solides arguments. Le point de départ du passionnant livre de Mathieu Léonard, Sobres pour la révolution.
– « Dans ton cul l'espoir » - À neuf ans, tu n'es pas grand-chose. En revanche, si t'es noir, tu peux être un criminel. C'est l'histoire que raconte Laurène Marx dans Portrait de Rita (Blast, 2025). Un texte court, écrit pour être entendu, qui raconte l'histoire d'une femme venue du Cameroun et qui se heurte au racisme, au patriarcat et à la violence de l'État.
***
Et aussi...
– L'édito – Fuck the pol'ICE
– Ça brûle ! – Criez hourra !
– L'animal du mois – La Corneille chasseuse de MAGA
– Abonnement - (par ici)